Au grand galop de l’Apocalypse
 C’est l’un des plus grands romans italiens du XXe siècle, retraçant l’histoire de la péninsule de 1940 à 1974 sur fond de guerre totalitaire et de déchristianisation. Le Cheval rouge d’Eugenio Corti est réédité.
C’est l’un des plus grands romans italiens du XXe siècle, retraçant l’histoire de la péninsule de 1940 à 1974 sur fond de guerre totalitaire et de déchristianisation. Le Cheval rouge d’Eugenio Corti est réédité.
En mai 1983, un petit éditeur catholique milanais, Ares (Associazione ricerche e studi), spécialisé dans les ouvrages de spiritualité et de théologie, ouvrait son catalogue à la littérature romanesque en publiant un premier roman d’un homme âgé de 62 ans : le Cheval rouge. L’auteur, Eugenio Corti, n’était pas un inconnu. Né en 1921 à Besana, dans la Brianza, une petite région de la province de Lombardie, entre Milan et Côme, il avait notamment écrit deux récits autobiographiques, La plupart ne reviendront pas (1947) et les Derniers Soldats du roi (1950), tirés de son expérience de la Seconde Guerre mondiale qui marqua profondément son oeuvre.
Fils d’un industriel du textile catholique, il était étudiant à Milan quand le conflit éclata. Enrôlé dans l’armée et devenu lieutenant, il demanda à être affecté sur le front russe et vécut la retraite de l’hiver 1942-1943 qui décima le corps expéditionnaire italien. De retour en Italie, il fut soigné et reprit du service dans les unités de l’armée qui, après la capitulation du pays (septembre 1943), avaient décidé de combattre aux côtés des Anglo-Américains dans la campagne lancée avec la prise de file de Pantelleria, qui culminera au mont Cassin. Les vingt-huit jours de la retraite russe et les combats acharnés contre les Allemands dans le centre de l’Italie forment la matière des deux essais qu’il publia au retour de la paix.
Mais l’écrivain ne se sentait pas quitte pour autant. Il avait témoigné de l’horreur des combats d’extermination menés par les nazis et les Soviétiques, ainsi que de l’épouvante du communisme “réel” découvert en Russie, mais il lui apparut que, pour dégager la signification profonde des événements qu’il avait vécus, il lui fallait avoir recours au roman. Non pas le roman tel qu’il se pratiquait alors dans les avant-gardes culturelles européennes, une expérimentation formelle fondée sur le rejet (du personnage, de l’intrigue, du réalisme), mais le grand roman inspiré du XIXe siècle, réaliste précisément, qui, en respectant la vérité des faits et la vérité morale des personnages, parvient seul à rendre vraiment compte de la réalité.
Onze ans de travail et de recherches furent nécessaires à Eugenio Corti pour mener à bien l’œuvre qu’il s’était fixée. Il ordonna ses souvenirs et les confronta à des sources et à des récits de première main. «J’ai été obligé de me constituer, d’un bout à l’autre, toute une base culturelle. Je devais parler d’événements liés au marxisme et au nazisme etje ne pouvais mefier à la culture officielle, viciée par les idéologies et par lesjeux de pouvoir », affirmera-t-il plus tard. Le résultat fut ce monument de près de 1500 pages qui retrace l’histoire de l’Italie de 1940 à 1974 (les trois quarts du livre étant concentrés sur la période 1940-1945).
Un roman épique avec des personnages principaux incarnés, des personnages secondaires à foison (dont de magnifiques figures de femmes et de prêtres) et une construction impeccable où alternent scènes collectives et “gros plans” ; un roman qui, par sa capacité à mêler les personnages à la grande histoire, sera un jour comparé à Guerre et Paix de Tolstoï ou à Vie et Destin de Vassili Grossman; un roman dont tous les événements historiques, la guerre en Russie et la découverte des goulags, la campagne d’Italie, la résistance des partisans rouges et royalistes en Italie du Nord ou la vie politique italienne au lendemain de la guerre, sont rigoureusement exacts.
Mais un roman qui, par son anticommunisme virulent et documenté et par la conviction qu’il porte que seule la déchristianisation de la société a permis aux hommes de se vautrer dans des massacres aussi inouïs (et que, partant, seul le christianisme pouvait les en préserver à l’avenir), heurtait de front les vérités officielles et les préjugés idéologiques d’une intelligentsia italienne encore marquée par le marxisme, et représentait ainsi un défi à la culture dominante. Logiquement, les grands éditeurs sollicités refusèrent tous le manuscrit, qui finit par atterrir chez le petit éditeur milanais dont nous avons parlé, qui le publia sans grands moyens, dans un silence hostile.
Ignoré par la critique officielle, le roman commença pourtant une diffusion souterraine inédite, jusqu’à devenir en quelques années un véritable phénomène littéraire, régulièrement cité par les lecteurs italiens parmi “les meilleurs romans contemporains”, au grand dam de ceux, il y en a heureusement de moins en moins, qu’il fait grincer des dents.
Le livre compte aujourd’hui 31 rééditions en Italie; il a été traduit, ou est en cours de traduction, dans de nombreux pays et des adaptations à la télévision italienne sont en préparation. En France, il est paru en 1996 à L’Âge d’homme dans une belle traduction de Françoise Lantieri, préfacé par François Livi. C’est cette édition qui reparaît aujourd’hui chez un autre éditeur suisse qui a entre pris de faire revivre une partie du catalogue de cet extraordinaire fondateur de L’Âge d’homme qu’était Vladimir Dimitrijevic, mort en 2011.
Le coeur géographique du roman se situe à Nomana, petite ville imaginaire de Brianza calquée sur celle où est né Corti. C’est de là que l’on part, là que l’on revient (quand on revient). La petite ville est le lien qui unit entre eux les principaux personnages du roman, formant un contraste saisissant entre la douceur de ses moeurs et la barbarie à laquelle ses jeunes habitants, principalement de la classe 1921, comme Corti, vont être confrontés. Parmi eux, la fratrie Riva. Leur père est un industriel du textile, ancien ouvrier devenu un patron humaniste et paternaliste dévoué à ses employés et aimé d’eux. La famille a adopté Manno, un neveu beau et brillant qui a perdu ses parents et qui partira faire la guerre en Libye avant de passer brièvement en Grèce et de rejoindre les unités italiennes combattant aux côtés des Alliés. Le fils aîné, Ambrogio, sera, lui, envoyé sur le front de l’Est avec ses amis Stefano, un paysan de Nomana, et Michele Tintori, un écrivain en herbe qui s’est porté volontaire en Russie pour saisir l’occasion d’enquêter sur le communisme (il sera servi).
Si Corti a probablement mis un peu de son expérience dans chacun de ses personnages, c’est Michele Tintori qui, avec sa carrière littéraire après-guerre, semblable à celle de l’écrivain, est le plus autobiographique. Quant au cadet des Riva, Pino, il s’engagera chez les partisans royalistes à la fin de la guerre et luttera contre les derniers fascistes de la République sociale italienne alliés aux nazis.
Tous sont des paolotti, autrement dit des catholiques pratiquants qui vivent selon la morale traditionnelle dans un monde encore totalement imprégné des valeurs chrétiennes. Leur foi profonde et leur conception spirituelle de la personne humaine déterminent leur vie sociale fondée sur l’honnêteté, la solidarité, l’amour du travail, mais aussi la chasteté avant le mariage (pour les hommes comme pour les femmes) et l’horreur du blasphème. Tout le roman repose sur l’idée qu’un monde avec de telles bases, un monde de limites, où l’on craint Dieu et où l’on respecte profondément la vie humaine, s’il n’est pas parfait, et même sous un régime fasciste, est incapable d’engendrer les horreurs que le triomphe des idéologies athées, nazisme et communisme, a permises.
À ce propos, Corti, peu favorable aux idées fascistes, étant lui-même conservateur, n’en remet pas moins les pendules historiques à l’heure en montrant que le régime mussolinien, plus autoritaire (et bouffon) que criminel, n’a rien à voir avec les deux totalitarismes du XXe siècle, ce que les historiens finissent du reste par admettre. S’il ne cache rien des agissements de certains sadiques de la république de Salo, représentés par le tortionnaire fasciste Praga (qui passera au communisme), il montre aussi que de tels individus, immanquablement attirés par les périodes de troubles, agissaient contre les ordres officiels, lesquels, sous Mussolini comme à Salo, n’ont jamais érigé la barbarie en système.
Les débuts en Russie d’Ambrogio, Stefano et Michele sont presque bucoliques. Postés sur le Don, les soldat attendent l’ennemi avec insouciance et se visitent d’une tranchée à l’autre en traversant la steppe à moto, faisant dînette au pied de leur mitrailleuse à l’arrêt en parlant du pays. Mais en décembre 1942, les Russes reprennent soudain l’offensive et enfoncent le front, au nord et au sud des lignes italiennes, opérant un large mouvement de tenaille qui menace d’enfermer les soldats de Mussolini dans une poche. Le 19 décembre, c’est la retraite dans la précipitation. Les Italiens n’ont pas le temps de récupérer l’essence et s’en fuient dans le désordre, abandonnant leurs véhicules en chemin lorsque ceux-ci tombent en panne. Par – 30 °C, affamés, assoiffés, épuisés au point de délirer, harcelés par des forces soviétiques sans pitié, les colonnes italiennes sont massacrées ou meurent de froid; les blessés qui ne peuvent plus avancer sont abandonnés au bord de la route malgré leurs suppliques désespérées.
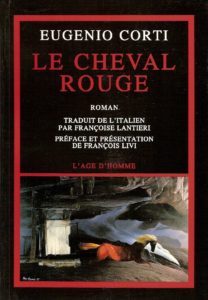 Montrer toute la réalité
Montrer toute la réalité
Prenant le parti de montrer toute la réalité, Corti multiplie les scènes pathétiques et déchirantes, en évitant ce manichéisme idiot et cet héroïsme de pacotille auxquels nous a habitués Hollywood (ce qui n’empêche pas les vraies scènes d’héroïsme, notamment celles concernant les chasseurs alpins italiens et les unités d’élite allemande). Il n’y a nul gentil et nul méchant dans cette retraite abominable, que de pauvres gens arriérés et fanatisés par la propagande qui massacrent d’un côté, et de pauvres gens terrorisés qui ne comprennent rien et se font massacrer de l’autre.
On réalise en lisant le Cheval rouge que nous sommes désormais tellement soumis à l’idéologie la plus crasse, celle qui consiste à juger les hommes d’après leur engagement, que Corti paraît par fois presque scandaleux, lui qui les juge d’après leurs mérites. Pour lui, la qualité d’une âme peut se révéler chez un homme qui s’est mis au service d’une cause exécrable, quand celui qui a choisi une cause élevée peut faire preuve de bassesse. Certains combattants fascistes ayant choisi de rester fidèles à l’alliance allemande pour des raisons d’honneur, sachant le sort qui leur était réservé et ne faisant rien pour l’éviter, provoquent le respect de l’écrivain, ce qui ne l’empêche pas de penser qu’il fallait les combattre pour le salut de l’Italie chrétienne.
Au “cheval rouge” emprunté à l’Apocalypse de saint Jean {«à celui qui le montait fut donné le pouvoir de bannir la paix de la terre pour faire s’entre-tuer les hommes», 6, 4) succède bientôt «le cheval livide» («celui qui le montait avait pour nom la Mort, et l’Enfer l’accompagnait», 6, 8) lorsque Michele, tombé aux mains des Russes, est interné dans un goulag. Là encore, l’écrivain ne cache rien des conditions de détention qui font sortir l’homme de son humanité, la faim poussant certains prisonniers à commettre l’irréparable en arrachant le foie des morts (et même, hélas, des agonisants…) pour s’en nourrir et ne pas mourir à leur tour.
De ces haines et de ces massacres «fondés sur la raison scientifique», de ces «guerres d’extermination entre peuples privés de Dieu », Michele s’inspirera, de retour en Italie en 1946, pour consacrer toute son énergie d’écrivain à lutter contre la déchristianisation, bientôt accélérée par les reniements d’une partie des catholiques eux-mêmes, et pour mettre en garde ses concitoyens tentés par le communisme, devenant ainsi l’ennemi de la nouvelle intelligentsia qui tente de le réduire au silence.
Car c’est aussi d’une immense manipulation de l’histoire que parle ce roman, une manipulation ayant permis aux auteurs et complices des plus grands massacres du XXe siècle de tenir le haut du pavé, de se présenter comme les champions du salut des hommes et d’échapper à leur responsabilité. Comme d’autres écrivains avant lui, et l’on pense bien sûr à Soljénitsyne, Corti a déchiré le voile et montré “le scandale de la vérité” dans un livre que plus rien désormais n’arrêtera.
(Olivier Maulin, 07/05/20, Valeurs Actuelle)
